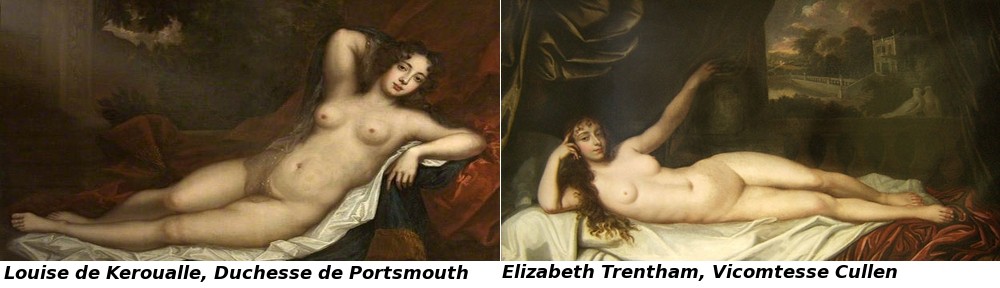Розалия Любомирская
Portrait par Anna Rajecka en 1791
Née le 16 septembre 1768 à Tchernobyl (Ukraine)
Morte le 30 juin 1794 à Paris (guillotinée)
Enterrée à Vincennes
Rozalia Chodkiewicz était la fille de Jan Mikolaj Chodkiewicz (1738-1781)et de son épouse Maria Ludwika Rzewuska (1744-1816). Elle était la cadette d’une famille de sept enfants. Son père était un riche propriétaire polonais ; il mourut brusquement à 42 ans alors que Rozalia n’avait que treize ans.
Sa mère, devenue veuve, fit de longs séjours à Varsovie en compagnie de ses enfants ; la famille maternelle de Rozalia Chodkiewicz, les « Rzewuski » relèvait de l’aristocratie polonaise. Le grand père de Rozalia (le père de sa mère) se nommait Waclaw Rzewuski (1705-1779) : en plus d’une carrière militaire il s’était fait connaitre grâce à ses poèmes et ses écrits en tant qu’auteur dramatique. Il terminera sa carrière politique en tant que castellan de Krakow et voivode de Krakow.
 Jan Mikolaj Chodkiewicz, père de Rozalia
Jan Mikolaj Chodkiewicz, père de Rozalia
Sa petite fille avait donc de grande chance d’obtenir un mariage prestigieux dans la noblesse polonaise. D’ailleurs, Rozalia était devenue rapidement une beauté : c’était une jolie blonde aux yeux bleus et rieurs et qui attira bientôt parmi ses prétendants le prince Aleksandr Lubomirski.
Le jeune homme était le castellan de la ville de Kiev, capitale de l’Ukraine : il était âgé de trente six ans, était célibataire mais aussi fabuleusement riche. En effet, le père d’Aleksandr, Stanislaw Lubomirski possèdait 31 villes de Pologne, 738 villages et avait un revenu annuel de 2 000 000 de slotis par an. Bref, lorsque le prince Aleksandr demanda la main de la jeune Rozalia, âgée seulement de dix neuf ans, rien ne s’opposa au consentement de la famille Chodkiewicz.
 Ludwika Rzewuska, mère de Rozalia
Ludwika Rzewuska, mère de Rozalia
Le couple fut marié en 1787 à Kiev, et très vite la jeune Rozalia se retrouva enceinte de son premier enfant. En septembre 1788, la jeune femme donna naissance à une petite fille à laquelle elle donna le nom d’ Alexandra Françoise. Le palais des Lubomirski situé à Opole Lubelskie reçut la visite du jeune couple.
Installée à Kiev, le couple va cependant très vite se disloquer, malgré la naissance de deux autres enfants : Léon en 1789, et Ludwika en 1790. En effet, le prince est volage et Rozalia ne supporte pas d’être délaissée. Ils ont cependant une passion commune : les idées nouvelles de la Révolution française : Rozalia se passionne pour les évènements qui ont lieu à Paris.
Son mariage battant de l’aile elle décide de se rendre à Paris pour être au plus près des évènements de l’époque. Son mari lui accorde ce séjour à Paris, et la recommande à l’ancienne maitresse du roi, Mme du Barry qui séjourne alors dans son château de Louveciennes.
 Mme du Barry par François Hubert Drouais en 1770
Mme du Barry par François Hubert Drouais en 1770
Rozalia Lubomirska arrive à Paris vers 1789 : sa beauté lui vaut de nombreux admirateurs. On lui prête des aventures sans lendemain. Sa réputation risquant d’en souffrir, elle se fait peindre par une compatriote polonaise Anne Rajecka en « jeune fille à la colombe » censée symboliser la virginité et l’innocence pour contredire les rumeurs qui la concernent. Elle revient à Varsovie au début de 1790, retrouve son époux et met au monde sa fille Ludwika. Son couple battant toujours de l’aile, elle décide de poursuivre ses voyages et se rend en Suisse en 1792.
Elle s’installe à Lausanne avec sa fille ainée Alexandra (Léon étant resté avec son père,et la petite Ludwika n’ayant pas survécu au-delà de quelques mois).
 Portrait de Rozalia par Geneviève Brossard de Beaulieu en 1788
Portrait de Rozalia par Geneviève Brossard de Beaulieu en 1788
Là, elle tient un petit salon où elle s’enthousiasme pour les idées révolutionnaires de la France : la Convention vient d’être constituée et elle se passionne pour le droit à la liberté des révolutionnaires, ce qui n’est pas du tout du gout des Suisses et notamment du baron d’Eslach, bailli de la ville de Lausanne, qui l’expulse de la ville prétextant qu’un des valets de la comtesse Lubomirska parle trop librement en Suisse des affaires de la France.
Rozalia quitte alors Lausanne le 10 octobre 1792 et suit son amant du moment le comte Thadée Mostowki, castelan de Varsovie et membre du Sénat de Pologne.
Ce dernier l’emmène à Paris où il doit s’acquitter d’une mission secrète avec la république française au nom du roi Stanislas Poniatowski. A Paris, les deux polonais se lient d’amitié avec les députés de la Gironde : Vergniaud, Brissot et Condorcet qui seront bientôt pourchassés pour leurs idées politiques (les deux premiers seront guillotinés le 31 octobre 1793, et le dernier le 28 mars 1794). La défaite du parti girondin et leur persécution détruisirent les entretiens du comte Mostowski avec le ministre des affaires étrangères.
 Portrait de Rozalia par Mme Anna Rajecka en 1791
Portrait de Rozalia par Mme Anna Rajecka en 1791
Bientôt tous ceux qui étaient associés aux Girondins furent regardés avec suspicion. A trois reprises, Rozalia et le comte Mostowski furent arrêtés puis relâchés. Le comte Mostowski sentant le vent tourné proposa à Rozalia de retourner à Varsovie mais elle refusa de le suivre.
Muni de son passeport le comte reprit donc seul la route et fut arrêté à Troyes. Il ne dut sa délivrance qu’à l’arrivée inattendue du député Hérault de Séchelles qui le fit libéré et lui permit de continuer sa route. Hélas, Rozalia n’eut pas cette chance, elle fut arrêtée le 29 brumaire An II (19 novembre 1793) à Paris et conduite à la prison de la Conciergerie.
 Rozalia « la belle endormie » par Mme Anna Rajecka en 1791
Rozalia « la belle endormie » par Mme Anna Rajecka en 1791
Extrait de son écrou : « Des registres du greffe de la Petite-Force. La citoyenne Alexandrine-Rosalie Lubomirska (sic), âgée de vingt-quatre ans, native de Charnovel, en Nockraine (sic), sans état, demeurant rue et quai Chaillot, n, 33, a été amenée et enregistrée par les citoyens Bétremieux et Legrand, inspecteurs de police, comme suspecte, en vertu d’une ordonnance des citoyens Laurent et Mennessiers, administrateurs de police. Délivré par moi, soussigné, ce 29 brumaire l’an second de la République française une et indivisible. »
Les perquisitions effectuées à son domicile rue Chaillot révélèrent des lettres de Rozalia à Mme du Barry où elle mentionnait un mot d’espérance sur le sort de la Reine et une « injuste persécution » : ces quelques mots étaient suffisants pour la condamner.
Le Tribunal Révolutionnaire la condamna pour conspiration royaliste le 22 avril 1794 et la condamna à la guillotine en même temps que Malesherbes (exécuté le 20 avril 1794) et Beatrix de Choiseul duchesse de Gramont (exécutée le 22 avril 1794). Or, étant étrangère elle ne ressortait pas des lois françaises : sa défense fut la suivante : « «que, bien loin d’avoir conspiré, elle a fui son pays pour respirer un air libre, et qu’elle a même été chassée de la Suisse pour cause de démocratie, et que, depuis qu’elle est en France, elle s’est plu à vivre au milieu des artistes». ».
 Portrait par école française de Rozalia
Portrait par école française de Rozalia
Sur le conseil d’une détenue, Rozalia se déclara enceinte pour surseoir à son exécution. Informée de son sort, son mari demeuré à Varsovie remua ciel et terre pour la sauver. Une nouvelle révolution avait éclaté en Pologne et les nouveaux leaders avaient écrits au Comité de Salut Public pour réclamer la libération de la princesse Lubomirska.
A Paris, l’abbé de la Tremoille, ami du prince avait proposé une forte somme d’argent à Barère (avocat et rapporteur du Comité de Salut Public) pour la libération de la princesse. Celui-ci se contenta d’empocher l’argent et de faire transférer Rozalia à la prison de la Force.
Ce déplacement causa un regain d’espoir et Rozalia se crut sauvée. Elle eut l’imprudence de déclarer qu’en fait elle n’était pas enceinte. Le jour même, le Comité de Salut Public apprenait que la princesse n’était pas enceinte et son sort était décidé : elle serait exécutée le jour même. La haine de Robespierre vis-à-vis des amis des députés de la Gironde ne devait s’assouvir que dans le sang. Elle eut le temps de tresser ses cheveux, puis de les couper pour les léguer à ses amis en France et en Pologne.
Le 30 juin 1794 (12 messidor an II) la princesse Lubomirska fut conduite à la guillotine et exécutée. Elle avait vingt cinq ans. Son corps fut enterrée à Vincennes. Ironiquement, moins d’un mois plus tard, Robespierre était arrêté, la Terreur prenait fin, et la princesse aurait pu survivre à son supplice.
La mort de la princesse Lubomirska provoqua un tollé de protestation en Pologne d’autant que la jeune femme était connue pour sa sympathie pour les idées de la Révolution. Sa mort tragique lança sa légende et l’on dit que son fantôme erre dans les couloirs du palais de Opole Lubelskie.
Quant à sa fille Alexandra, âgée de quatre ans, et incarcérée avec elle, elle demeurera à la prison de la Force. : elle ne sera libérée qu’après le 9 thermidor (28 juillet 1794) et confiée à Izabella Lezenska. Elle sera rendue à son père le prince Lubomirski.
Ce dernier ne devait survivre que dix ans à son épouse, il mourut à 53 ans le 13 juillet 1804 à Vienne ne s’étant jamais remarié.
 Alexandra comtesse Rzewuski, fille de Rozalia
Alexandra comtesse Rzewuski, fille de Rozalia
La jeune Alexandra abandonnera alors le prénom de sa naissance pour prendre celui de sa mère, Rozalia. Son tuteur, Severin Rzewuski, lui fit épouser son propre fils, c’est ainsi qu’elle épousa à Vienne le 17 aout 1805 un lointain cousin, le comte Waclaw Seweryn Rzewuski (1785-1831).
Elle lui donnera quatre enfants avant d’être abandonnée par son époux en 1817. La fille de la comtesse guillotinée devait finir sa vie au château d’Opole près de Lublin avec ses quatre enfants. Elle mourra à Varsovie en janvier 1865 à 76 ans.
Descendants de Rozalia Chodkiewicz
Jusqu’aux arrière-petits-enfants.
Rozalia Chodkiewicz, née le 16 septembre 1768, Tchernobyl, décédée le 30 juin 1794, Paris (guillotinée) (à l’âge de 25 ans).
Mariée en 1787 avec Aleksander Lubomirski, né en 1751, décédé le 13 juillet 1804, Vienne (Autriche) (à l’âge de 53 ans), generał wojsk francuskich, kasztelan kijowski 1785-90, dont
- Rozalia Lubomirska, née le 3 septembre 1788, Paris (75), baptisée, Saint-Sulpice, Paris, décédée le 20 janvier 1865, Varsovie (Pologne) (à l’âge de 76 ans).
Mariée le 17 août 1805, Vienne, avec Wacław Seweryn Rzewuski, né en 1785, décédé le 14 mai 1831 (à l’âge de 46 ans), dont- Stanislaw, né le 24 juin 1806, Vienne (Autriche), décédé le 2 juillet 1831, Cracovie (Pologne) (à l’âge de 25 ans).
Marié en mai 1831 avec Józefina Walicka, née le 27 mars 1808, Warszawa, décédée le 20 mai 1880, Kraków (à l’âge de 72 ans). - Léonce, né le 13 avril 1808, Vienne (Autriche), décédé le 21 octobre 1869, Cracovie (Pologne) (à l’âge de 61 ans).
Marié en 1850 avec Taida Małachowska, née en 1820 ou 1821, décédée. - Caliste Rzewuska, née le 15 août 1810, Opole, décédée le 24 juillet 1842, Castel Gandolfo (à l’âge de 31 ans).
Mariée le 20 mars 1840, Rome (Italie), avec Michelangelo, Duca Caetani, duca di Sermoneta (13e, 1850), principe di Teano, né le 20 mars 1804, Rome (Italie), décédé le 12 décembre 1882, Rome (Italie) (à l’âge de 78 ans), dont- Hersilia, née le 12 octobre 1840, Rome (Italie), décédée en 1925 (à l’âge de 85 ans).
Mariée le 31 janvier 1859, Rome, avec Giacomo Colombo-Lovatelli, décédé le 20 septembre 1879. - Onorato, Duca Caetani, duca di Sermoneta (14e, 1882), né le 18 janvier 1842, décédé le 2 septembre 1917 (à l’âge de 75 ans), député, ministre des affaires étrangères du royaume d’Italie (1896).
Marié le 11 juillet 1867, London, avec Ada Bootle-Wilbraham, née le 14 juillet 1846, London, décédée le 16 août 1934, Roma (à l’âge de 88 ans).
- Hersilia, née le 12 octobre 1840, Rome (Italie), décédée en 1925 (à l’âge de 85 ans).
- Withold, né en 1815, Vienne (Autriche), décédé le 12 juin 1838, tué dans un engagement dans le Caucase (à l’âge de 23 ans).
- Stanislaw, né le 24 juin 1806, Vienne (Autriche), décédé le 2 juillet 1831, Cracovie (Pologne) (à l’âge de 25 ans).
- Léon, décédé en 1869.
- Ludwika Lubomirska, née en 1790